 |
C'est
là que j'ai vu le jour, il y a un certain nombre d'années,
voire un nombre d'années certains… Tout dans ma vie
me rattache et m'a toujours rattaché à cette région,
si inhospitalière pourtant au premier abord, avec ses paysages
lunaires dévastés, les montagnes de déchets
industriels et des trous laissés par les affaissements miniers.
|
|
La
Haute, la Noire.




|
Mon
père était électricien dans la mine, mes deux
grands-pères étaient respectivement mineur et électricien
dans la mine, mes oncles étaient mineurs et sauveteurs, miniers
bien sûr. Mon frère aîné est chercheur
dans les radiations naturelles des mines, mon deuxième frère
a passé sa vie professionnelle dans une mine aussi.
La mine a rythmé ma vie, j'ai appris à nager dans
la piscine de la mine, gamine, j'allais en colonie de vacances
dans les Sudètes, vers Klodzko, colonie organisée
et payée par la mine, adolescente, j'allais au bord de
la Baltique dans un centre de vacances, des bungalows de la mine.
Pour chauffer la maison familiale, nous allions chercher notre
contingent de charbon, gratuit, à la mine, même les
patates pour l'hiver, on les achetait par l'intermédiaire
de la mine. C'était notre mère, notre gagne pain,
notre vie, la priorité économique.
Mes copines étaient toutes filles de mineurs, les quelques-unes
qui n'avaient pas de père mineurs, avaient des oncles,
cousins, frères qui allaient à la mine tous les
jours. Pas forcément la même, on avait l'embarras
de choix, les mines se comptaient par dizaines à une dizaine
de kilomètres à la ronde. Personne n'échappait
à la règle, on était tous étroitement
liés à cet or noir.
La Silésie nous nourrissait, la Silésie nourrissait
la Pologne pendant des années, faisait des envieux et était
souvent favorisée par les autorités pendant les
années noires de l'histoire contemporaine. Les mineurs,
on les soignait, on les payait grassement, il n'y avait pas beaucoup
de volontaires pour aller risquer leur vie à casser cet
or noir, il ne fallait pas les mécontenter. Quand en 1970,
à Gdansk, l'armée s'en prenait aux ouvriers, la
Silésie n'a pas bougé, surprotégée
et privée des informations réelles. Quand en 1980,
toujours à Gdansk, l'histoire a encore une fois parlé
par l'intermédiaire des ouvriers des chantiers navals,
la Silésie s'est levée, en contribuant ainsi au
mouvement national et à la création de la nouvelle
Pologne.
Elle a payé un lourd tribut, la Silésie, polluée
jusqu'au cœur par des années d'exploitation industrielle
maximum, ses terres sont chargées de plomb et autres métaux
lourds, l'air, irrespirable pendant des années, connaît
quelque répit, mais il faudra de longues années
avant que la Silésie ne réussisse à dépolluer
l'environnement.
|
BLASON
Le blason de la Haute Silésie est un aigle, faisant référence
au blason des Piast de la Haute Silésie du XIIIème
et XIVème siècle, dont le graphisme a été
légèrement mis au goût du jour. L'aigle jaune,
ou or selon les représentations, a la tête tournée
à droite, sans couronne, les éléments de
son corps, ailes, queue sont représentés sans fioritures
ou autres éléments décoratifs. Le fond du
blason est bleu ciel. La simplicité du blason est directement
inspiré par les sources historiques, les couleurs aussi.
http://www.silesia2000.pl/index.html
DRAPEAU
Le drapeau silésien reprend les mêmes couleurs :
jaune (ou or) et bleu, en trois bandes horizontales : 2/5 de bleu
en haut et en bas et on milieu 1/5 de jaune. Une particularité
néanmoins, le drapeau peut être présenté
à l'horizontale et à la verticale.
QUELQUES CHIFFRES
Le territoire de la Haute Silésie s'étend sur un
peu plus de 12.000 km2, ce qui place la voïévodie
à la 14ème place nationale. Il y a 68 centres urbains
dans la voïévodie, ce qui constitue le record absolu
en Pologne, 22 d'entre eux sont qualifiées " grandes
villes ", seulement 2,6 % de la surface est consacrée
à l'agriculture.
La population de la Haute Silésie c'est presque 5 millions
d'individus, ce qui la place au deuxième rang national
et compte tenu de la surface assez réduite, à la
première place nationale côté densité.
Il y a 398 habitants par kilomètre carré en Silésie,
contre 123 pour une moyenne nationale.
323.000 entreprises sont enregistrées en Silésie,
elles emploient quelque 3 millions de salariés, ce qui
constitue 13,02 % de toutes les entreprises polonaises et 21,25
% de salariés au niveau national, donc plus d'un Polonais
sur 5 exerce son activité professionnelle sur le territoire
de la Haute Silésie.
Est-il vraiment utile d'ajouter que c'est la région la
plus industrialisée et la plus urbanisée de la Pologne,
son infrastructure en matière de télécommunications
et réseaux routiers la met également à la
première place nationale dans ce domaine.
HISTOIRE
La première mention concernant la Haute Silésie
date du IXème siècle, les habitants répertoriés
vivaient sur les rives de l'Oder et de ses affluents, selon les
renseignements fournis par les fouilles archéologiques,
ils vivaient essentiellement de l'agriculture et élevage
du bétail, mais ils pratiquaient également l'artisanat.
Les renseignements concernant le Moyen Age sont très peu
nombreux. La dynastie des Piast y a pris le pouvoir entre 985
et 990, ainsi la Haute Silésie est devenue une partie intégrante
de l'Etat polonais et constituait une zone de sécurité
entre la Pologne et les Tchèques d'une part, l'Allemagne
d'autre part. Boleslaw Chrobry, conscient de l'importance stratégique
de la Silésie, y a élevé de nombreux châteaux
forts, il a notamment créé l'archevêché
de Wroclaw.
Le sort de la Silésie a depuis été conditionné
par le sort de la Pologne, l'éclatement de la Pologne,
dû au testament de Boleslaw Krzywousty en 1138, l'a placé
entre les mains du fils aîné, Boleslaw III, au même
titre que la région seigneuriale de la capitale, Cracovie.
Hélas, Boleslaw III n'a pas su imposer son pouvoir de roi
à ses frères, les guerres fratricides ont donc eu
pour conséquence les interventions étrangères,
notamment tchèques et allemandes. Les souverains successifs
ont vainement essayé, au fil des ans, de réunifier
le pays, essais auxquels l'invasion turque et la défaite
de Legnica en 1241 on mis définitivement fin.
La Silésie s'est donc retrouvée divisée en
petites principautés, dont les souverains étaient
sous l'influence tchèque et allemande.
Néanmoins, c'est là que commencent les années
fastes pour la région. Le développement culturel
et économique est à son apogée, le commerce,
l'artisanat, l'exploitation minière de l'argent, plomb
et or constituent les principaux atouts de la région.
Les villes se développent, les gens s'enrichissent.
Jusqu'à ce que le roi tchèque, au début
du XIVème siècle, impose son pouvoir absolu en Haute
Silésie d'abord, Basse Silésie ensuite, il devient
ainsi le propriétaire de la riche région, décision
confirmée en 1348, où le roi polonais Kazimierz
Wielki, après sa défaite contre les Chevaliers Teutoniques
(Chevaliers de la Croix) a renoncé officiellement à
ses droits sur les deux Silésies, au profit du puissant
voisin du Sud, qui par ailleurs aspirait non seulement à
la couronne silésienne, mais à la polonaise tout
court.
Ainsi, diverses principautés silésiennes changeaient
de mains, de souverains pendant plusieurs siècles, ces
changements incessants ont eu pour conséquence la création
d'une nouvelle forme de propriété féodale
- les petits états indépendants, inaugurés
par la création de celui de Pszczyna en 1546, puis celui
de Bytom en 1697, dont les représentants siégeaient
à la Diète Silésienne. A cette époque,
les habitants de la Silésie se consacraient essentiellement
au jardinage, agriculture, élevage, pêche, sans oublier
l'artisanat, l'industrie minière et le commerce.
La guerre des 30 ans (1618-1648) apporte à la région
le vide et la désolation, ce que la guerre n'a pas réussi
à détruire, les épidémies l'ont fait,
la population a été décimée, les villes
détruites. Les guerres de Silésie ont suivi (1740-42
et 1744-45), elles ont eu pour conséquence le rattachement
de la Silésie (sauf la région de Cieszyn) à
la Prusse et l'Autriche, puis la guerre de 7 ans (1756-63) a définitivement
contribué au rattachement de la région à
la Prusse. L'envahisseur germanique voulant asseoir sa main mise
sur ces terres convoitées, il colonise la région
en y envoyant en nombre la population allemande de souche, sans
pour autant réussir à changer l'esprit nationaliste
polonais de la population silésienne, surtout dans les
campagnes.
Le XVIII et le XIX siècles apportent d'autres modifications
dans la vie silésienne, liées à l'explosion
industrielle dans la région.
L'industrie sidérurgique se développe surtout aux
environs de grandes villes : Gliwice, Zabrze, Chorzow et Katowice,
avec, de nouveau, une très forte affluence de la population
allemande. En même temps, le transport se développe,
avec la construction d'un important réseau des chemins
de fer. L'artisanat recule, au profit de la production manufacturée,
moins chère.
Vers le milieu du XIX, avec le Printemps des Peuples, l'esprit
nationaliste polonais du peuple silésien atteint son sommet,
les Polonais de la Silésie, par le biais de leurs représentants
à Berlin et Francfort, demandent le retour de la langue
polonaise dans les écoles. " Le Journal de la Haute
Silésie " est édité à Bytom,
" Le Télégraphe de la Haute Silésie
" à Olesno, ces journaux, écrits en polonais,
ont contribué à la sauvegarde de la langue polonaise
dans la Silésie occupée, ainsi que la réintroduction
de la langue polonaise dans le système scolaire entre 1848
et 1870.
D'autres journaux et revues continuent à être édités,
malgré les persécutions et les interdictions prussiennes
et autrichiennes.
Beaucoup d'organisations pro-polonaises sont créées
entre la fin du XIXème et le début du XX ème
siècle et c'est grâce à ces petites ou grandes
structures, très nombreuses, que les Polonais de Silésie
ont réussi à préserver leur polonité
et ont été si nombreux à participer aux trois
insurrections de Silésie.
Cette période a également connu un très
fort développement des parties politiques et du syndicalisme,
liés au très fort développement industriel
de la région.
Et puis la 1ère guerre mondiale éclate et avec
elle l'espoir de la fin de la main mise prussienne et autrichienne
sur la Silésie renait, surtout avec la défaite allemande
et l'éclatement de l'empire Austro-Hongrois.
Vers la fin de l'année 1918 une organisation clandestine
Organisation Militaire Polonaise est créée avec
pour but la préparation d'une insurrection qui fera revenir
la Silésie à la Pologne.
La situation internationale n'est pas très réjouissante
et l'état polonais qui se reconstruit ne réussit
pas à gagner sur le tracé de sa frontière
sud-ouest. Un plébiscite, le Plébiscite, va donc
être organisé et c'est la population silésienne
elle-même qui va se prononcer sur son appartenance. Les
autorités allemandes en place commencent donc une grande
action, la chasse aux organisations pro-poloniennes, la chasse
à l'homme, aux hommes, les arrestations, etc.
C'est donc ainsi que la première insurrection de Silésie
éclate en 1919, la nuit du 16 au 18 août, mal préparée,
trop rapidement commencée, elle se termine vite par une
défaite cuisante.
Dès février 1920, la Haute Silésie est donc
gouvernée par La Commission Plébiscitaire avec son
siège à Opole. Et puis, la nuit du 19 à 20
août 1920, la deuxième insurrection de Silésie
éclate, grâce à elle, le monde entier prend
conscience de la situation dans laquelle se trouve le peuple silésien,
terrorisé et martyrisé par l'occupant. Mais elle
se termine sans résoudre aucun problème.
Enfin, la politique allemande, déplaçant des allemands
vivant aux quatre coins du Reich, dans le but de prendre part
au Plébiscite et d'en fausser les résultats, avec
pour conséquence une mauvaise conclusion pour la Silésie
polonaise, avec un très léger avantage pour l'occupant,
provoque le pas décisif : la troisième insurrection
de Silésie.
Wojciech Korfanty prend la tête de ce soulèvement
de dernière chance dans la nuit du 2 au 3 mai 1921. Plusieurs
batailles ont lieu, dont les plus importantes se sont déroulées
dans la région d'Opole, comme à Gora Swietej Anny.
Enfin la victoire et la Pologne récupère environ
29 % du territoire de la Silésie, avec la plus grande partie
de son potentiel industriel.
La première voïévodie de Silésie est
créée. La Silésie, avec sa capitale Katowice,
explose de nouveau, construit des routes, des écoles, des
immeubles d'habitation, l'industrie se réveille après
la crise de 1925-1935.
Une partie de la Silésie reste pourtant toujours rattachée
à l'Allemagne, les grandes villes telles que Bytom, Gliwice
et Zabrze restent de l'autre côté de la frontière.
La population polonaise, restée du mauvais côté
de la frontière, est désormais protégé
par la convention de Genève.
En 1933, Adolphe Hitler devient chancelier et des nouvelles répressions
commencent, surtout dans la région d'Opole.
En 1939 la guerre éclate, l'armée allemande entre
en Pologne et récupère tout le territoire de la
Silésie, toutes les organisations polonaises sont dissoutes
et interdites, les combattants des insurrections de Silésie
arrêtés, fusillés ou déportés
dans les camps de concentration. Les autres habitants de la région
sont fortement " invités " à s'inscrire
sur la liste nationaliste allemande, appelé Volkslist.
Malgré les menaces, beaucoup de Silésiens n'ont
jamais apposé leurs signatures sur cette fameuse liste,
malgré les risques encourus. La résistance des Silésiens
est plus forte que jamais et devient une légende. C'est
seulement en 1945, après la libération de la région
par l'Armée Rouge, que tout le territoire de la Silésie
redevient partie intégrante de l'Etat Polonais.
La voïévodie silésienne, telle qu'elle est
maintenant, a été créée en 1999.
|
|
|
Géographie
Le paysage de la Silésie est très varié
: les montagnes au Sud, faisant partie des Karpates, avec le Beskid
Silésien, le Beskid de Zywiec, appelé également
le Beskid Haut et puis le Petit Beskid. Viennent après
les pittoresques territoires de Pogorze Slaskie, Wyzyna Slasko-Krakowska,
Wyzyna Slaska, Wyzyna Woznicko-Wielunska et enfin Nizina Slaska.
Les grandes villes
Katowice http://www.um.katowice.pl/index.php
La ville de Katowice est la capitale de la voïévodie
et de l'Agglomération Industrielle de la Haute Silésie.
La ville, avec " sa banlieue " constitue le plus grand
centre de l'industrie minière, métallurgique, électromécanique,
électronique et chimique en Pologne.
C'est également un important centre scientifique (12 écoles
supérieures, quelques dizaines d'instituts de recherches
scientifiques) et culturel (Théâtre de Silésie,
Philharmonie de Silésie, Orchestre Symphonique National
de la Radio Polonaise, Bibliothèque de Silésie).
La ville occupe la surface de 164,7 km2 et se compose de plusieurs
quartiers historiques et des villages rattachés au fil
des ans à la municipalité de Katowice, on compte
parmi eux Bogucice, Brynów, Dab, Dabrówka Mala,
Giszowiec, Józefowiec, Kostuchna, Koszutka, Ligota, Murcki,
Ochojec, Panewniki, Piotrowice, Podlesie, Szopienice, Welnowiec,
Zaleze, Zarzecze.
Katowice est situé sur le Plateau de Silésie, sur
les deux rives de la rivière Rawa, invisible dans le centre
ville puisqu'elle a été recouverte à cause
d'une pollution très importante.
La première information concernant le village de Katowice
date de 1598, mais l'histoire de la ville est liée à
celle des bourgades des agriculteurs slaves. En ce qui concerne
la chronologie, Dab est le quartier le plus ancien. Les documents
de 1299 en font déjà mention. Entre le Xe et le
XIV e siècle, ses terrains faisaient partie de l'état
polonais, puis de la Bohème et, depuis 1742, de la Prusse.
La ville a acquis ses droits urbains en 1865.
Après la participation de très nombreux habitants
de la ville aux trois insurrections silésiennes (1919 -
1921) et au Plébiscite, la ville Katowice a rejoint l'état
polonais le 20 juin 1922.
La période d'entre les deux guerres a connu un développement
industriel intensif. La ville s'est transformée : d'une
petite agglomération industrielle des périphéries
de la Prusse, elle est devenue le centre économique de
la Pologne, la capitale de la plus riche des régions polonaises.
BYTOM http://www.um.bytom.pl/
La ville de Bytom a acquis ses droits urbains 1254. Elle a appartenu
aux Piast d'Opole jusqu'en 1532, ensuite au Brandenbourg, à
l'Autriche et, à partir de 1741, à la Prusse. En
1848, Lompa, Szafranek i Smolka y publiaient la revue "Journal
de Haute Silésie", la première organisation
polonaise en Silésie (Club National) y a été
créée à la même époque.
Dans les années 1919 - 1921, le Commissariat polonais de
Plébiscite a eu son siège dans la ville de Bytom
qui, après le Plébiscite, a été attribuée
à l'Allemagne. Elle est redevenue polonaise à la
libération, en 1945.
Aujourd'hui, malgré la crise dans l'industrie silésienne,
Bytom continue à être un important centre d'industrie
minière et métallurgique. 6 mines de charbon sont
exploitées dans la ville, entre autres, les mines Bobrek
et Szombierki ainsi que 2 complexes sidérurgiques.
Bytom est une des plus grandes villes du Bassin Industriel de
la Haute Silésie et un grand centre ferroviaire.
Mais Bytom est aussi un centre culturel, la ville abrite l'Opéra
de Silésie et le Théâtre Silésien de
la Dante.
GLIWICE
http://www.um.gliwice.pl
La ville de Gliwice s'est développé au croisement
des voies commerciales qui menaient de Cracovie vers Opole et
Wroclaw. On retrouve les premières mentions concernant
la ville au XIIIe s. Depuis 1312, la ville est la capitale du
duché de Gliwice. En 1526, elle se retrouve entre les mains
de Habsbourg et, depuis 1740, fait partie de la Prusse. Durant
la première moitié du XVIIIe s., les filatures et
le tissage se développent dans la ville de Gliwice. A la
fin du XVIIIe s., c'est le tour de l'industrie lourde, les premiers
complexes sidérurgique voient le jour à Gliwice.
En 1789, le premier four à charbon y est construit.
Entre le XIXe s. et le XXe s., Gliwice devient un important centre
de défense de la nationalité polonaise en Silésie,
plusieurs promoteurs du retour de la Haute Silésie Pologne
y menaient leurs activités. De nombreuses organisations
polonaises se trouvaient ici. Malgré les efforts des polonistes
de Gliwice, la ville s'est retrouvé du côté
allemand à l'issue du plébiscite de 1921, elle appartenait
à la République de Weimar.
Aujourd'hui, Gliwice reste un grand centre de l'industrie minière,
métallurgique, mécanique, de la métallurgie,
chimie, mais aussi de l'industrie agroalimentaire.
Elle est toujours un important centre culturel et scientifique,
l'Ecole Polytechnique de Silésie y a son siège,
ainsi que d'autres écoles supérieures et plusieurs
institut de recherche.
ZABRZE http://www.um.zabrze.pl/
La première mention sur la ville de Zabrze date de 1242,
on y parlait de la bourgade de Biskupice, qui est à présent
un des quartiers de la ville. Depuis 1327, Zabrze appartenait
aux Tchèques, puis, à compter de 1526, aux Habsbourg
et enfin depuis 1742, à la Prusse. La première mine
de charbon (a présent, la mine Zabrze) y a été
ouverte en 1791. L'industrie dans la ville a connu un très
fort développement après la mise en service du Canal
de Gliwice, en 1823 et de la ligne de chemin de fer Wroclaw -
Myslowice, en 1846. Jusqu'en 1810, la ville faisait partie du
patrimoine des évêques de Wroclaw. Depuis 1842, elle
appartenait au comte Henckel von Donnersmark.
Zabrze est un des principaux centres des insurrections silésiennes
(1919-1921). Après le Plébiscite de 1921, elle se
retrouve sur le territoire allemand sous le nom de Hindenburg.
Zabrze a acquis ses droits urbains en 1922. Elle est revenue à
la Pologne à la libération de 1945.
Zabrze est un grand centre du Bassin Industriel de la Haute Silésie,
mais aussi un important centre scientifique et culturel. L'Académie
Polonaise des Sciences, Orchestre Philharmonique de Haute Silésie,
Nouveau Théâtre G. Morcinek, Maison de la Musique
et de la Danse y ont leurs sièges.
http://www.um.zabrze.pl/
PIEKARY SLASKIE http://www.um.piekary.pl/
La colonie minière de Piekary a été mentionnée
la première fois en 1277. A compter du 1289, avec tout
le duché de Bytom, la ville appartenait à la Tchéquie,
et, depuis 1526, aux Habsbourg. Elle abrite la célèbre
basilique Notre Dame de Piekary, célèbre notamment
grâce au rois polonais Jean III Sobieski, qui s'y est arrêté
en 1742, pour prier, en allant au secours de la ville de Vienne,
occupée par les Prussiens.
Depuis la moitié du XVIIIe s., Piekary est un important
lieu de pèlerinages, grâce au tableau miraculeux
de la Vierge de Piekary.
Au XIXe s., plusieurs organisations polonaises se sont installées
dans la ville. En 1840, T. Heneczek y a ouvert la première
imprimerie polonaise de la Haute Silésie. Dans les années
1919 - 1921, les habitants ont participé aux insurrections
silésiennes. En 1920, suite au Plébiscite, la ville
de Piekary a été attribuée à la Pologne.
En septembre 1939, au début de la seconde guerre mondiale,
la ville a été défendue par des anciens insurgés
et par des éclaireurs (scouts). Les Allemands, en répression,
ont fusillé 53 personnes en prenant possession de la ville.
En 1939, Piekary a reçu les droits urbains qui n'ont été
effectifs qu'après la guerre.
Grande agglomération minière (extraction de minerais
de zinc et de plomb, de charbon), Piekary abrite également
l'industrie de bâtiment, mécanique, de l'habillement
et l'industrie agroalimentaire.
|
|
| Coups de cœur
La Silésie n'est pas que
grisaille, désolation et industrie.
Elle cache un véritable trésor pour les touristes.
Difficile de tout aborder, il faut faire un choix, commençons
donc :
Szlak Orlich Gwiazd - La piste des nids d'aigles
Le Jura de Cracovie-Czestochowa est déjà une grande
attraction touristique, pour ceux qui aiment l'histoire et la randonnée.
D'abord les paysages enchanteurs, qu'on découvre le plus
souvent à pied, parsemés de vestiges de l'histoire
polonaise. La piste la plus connue, numéro un sur la liste
des chemins de randonnées en Pologne, est celle des Nids
d'Aigles. Vous y trouverez un relief hors du commun, de très
nombreux monuments historiques, des grottes et une faune très
intéressante. On peut y évoluer à pied, en
vélo, à cheval, à ski.
Que faut-il y admirer en priorité ?
Les ruines de plusieurs châteaux du Moyen Age, dont ceux
de Olsztyn, Ostreznik, Mirow, Siewierz, Ogrodzieniec, Lipowiec,
j'en passe, et des meilleurs.
Mais il y a aussi des châteaux et palais intacts et ouverts
au public, comme celui de Bedzin et Pieskowa Skala.
Certains villages sur le tracé témoignent d'une architecture
hors du commun, comme Pilica, Zarnowiec, Olkusz, Bedzin etc.
Sans oublier la ville rendue célèbre par la Vierge
Noire, Czestochowa avec son monastère de Jasna Gora.
La mine musée de Tarnowskie Gory
Tout le monde connaît la mine de sel de Wieliczka. Allez
donc visiter l'autre, celle de Tarnowskie Gory, alors là,
vous ne serez pas déçus, dépaysement assuré,
sensations fortes aussi. Bien sûr, si vous êtes trop
grand, prévoyez de quoi soigner votre mal de tête,
puisque le plafond est bas, on vous fournit tout de même le
casque obligatoire.
En tout cas le déplacement vaut la peine, pour un prix modique,
vous avez une visite guidée d'une vraie mine, avec ses couloirs
bas et étroits, y compris une promenade en barque sur une
rivière souterraine, super, j'en ai fait personnellement
expérience et selon l'avis de mes propres enfants, les sensations
étaient plus fortes qu'à Wieliczka même.
Il s'agit là d'une mine de plomb et d'argent, située
à Tarnowskie Gory, le berceau de l'industrie minière
et un des plus important nœud ferroviaire de la région.
La ville elle-même a été créée
autour des exploitations du minerai de plomb et d'argent entre le
11ème et 12ème siècles.
Le puits de la Truite Noire
Pendant que vous y serez, à Tarnowskie Gory j'entends, après
la visite de la mine, prévoyez d'aller faire un tour à
côté, pas bien loin, pour visiter le Puits de la Truite
Noire. Il s'agit d'un couloir minier d'une longueur de 600 mètres,
faisant partie de l'ancienne mine du zinc et de plomb Fryderyk.
Le couloir est inondé et vous faites une promenade en barque
le long de la rivière souterraine. N'oubliez pas vos gilets,
ce n'est pas climatisé, et pas chauffé du tout. Mais
le détour en vaut la peine.
Les lieux du culte
La région abonde en églises de tous les styles.
Vous pourrez admirer des églises de style romane à
Cieszyn (la Rotonde de Saint Nicolas, construite en pierre de taille
en le XI et XII siècle) à Rudy, l'église du
monastère des cisterciens du XIIIe siècle, avec sa
chapelle du 1726. Mais aussi celle de Wojkowice Koscielne, avec
ses deux chapelles baroques.
Les églises gothiques sont très bien représentées
en Silésie, notamment celle de Bytom, avec des décorations
intérieures resplendissantes, l'Eglise de Tous les Saints
de Gliwice, celle de Gliwice Szobiszowice, Raciborz et Zory. Et
puis les baroques, avec l'Eglise Saint Adalbert (Wojciech) de Bytom,
le monastère baroque des Dominicaines de Aleksandrowka, Myslowice,
Pszczyna, Pszow.
Sans oublier, bien sûr, la Basilique néo-romane de
Piekary Slaskie, avec son célèbre effigie de Vierge
Marie et le célèbre Calvaire, bâti sur le sommet
d'une colline entre 1893 et 1896, avec ses stations de chemin de
croix et de très nombreuses chapelles.
http://www.kuria.katowice.pl/~piek_sl/
Mais la région abrite également une église
orthodoxe de 1889, dans la ville de Sosnowiec, avec de très
belles icônes de l'atelier moscovite de Labiedev et de très
nombreux cimetières juifs, représentant un vrai patrimoine
historique et architectural, dont ceux de Bedzin, Bielsko Biala,
Bierun, Bytom, Gliwice, Katowice etc.
SPORT
La ville de Chorzow abrite sur son territoire le plus grand stade
de la Pologne, le Stade de Silésie. Il se trouve sur le terrain
du Parc de la Culture et du Repos. Les plus grands matchs de l'histoire
du foot polonais se sont joués ici, mais on y organise aussi
des concerts de rocks. Le stade a quelques 60.000 places, est très
bien desservi par les transports en communs, extrêmement bien
développés dans la région. Son cadre et la
proximité d'un centre hôtelier sont autant d'atouts
pour son développement.
Après l'effort, le réconfort. Pendant que vous serez
à Tarnowskie Gory, faites donc un tour dans le Parc Aquatique,
ouvert en mars 2001 et déjà très couru. Il
s'agit là d'un complexe digne des plus grands au monde et
unique dans son genre en Pologne. Le Parc se situe sur une surface
de 9.000 m2 et il allie la pratique sportive, jeu et détente
pour tous les âges. Le parc comprend une piscine de 25 mètres
avec sa tribune, une piscine pour l'apprentissage de la nage, un
bassin d'eau salée, une piscine à vagues, une piscine
" rivière ", trois toboggans (47 -71 -108 mètres),
piscines récréatives, genre jacuzzi, sauna finlandaise
et sauna romaine - qui dit mieux ? ? ? Mais ce n'est pas tout, vous
pouvez profiter d'une salle de sport et de la musculation pour des
professionnels, d'un solarium et des massages à la carte.
Vous hésitez encore ? Sachez que les heures d'ouverture vous
permettront d'y aller avant ou après la visite de la région,
puisque le complexe est ouvert de 6 heures du matin au 22 heures
du soir. Ah oui, j'oubliais, vous pouvez les appeler au +48 32 393
39 00 ou par Internet http://www.pwtg.silesia2000.pl/.
En fait, il y en a plein d'autres, j'aimerai vous en parler encore
et encore…
Une prochaine fois, vous avez dit, à bientôt alors.
Et amusez-vous bien, en Silésie, bien sûr…
Sabine@beskid.com
|




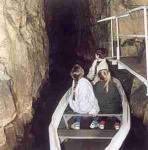


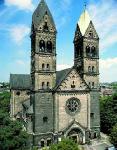

|
|

